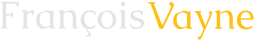La Méditerranée deviendra-t-elle un “Lac de Tibériade” de la fraternité universelle?

Découvrez une jeune catéchiste de feu : la bienheureuse Eugénie Joubert
20 février 2025
« Celui qui répand le Rosaire est Saint! »
8 mars 2025Entretien avec le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille (pour l’hebdomadaire italien Famiglia Cristiana)
. Eminence, comment le projet MED25, qui consiste à faire naviguer en Méditerranée des jeunes de diverses religions, est-il né?
L’odyssée MED25 n’est pas un projet isolé ! Elle est la dernière-née d’unprocessus de communion initiée par le Cardinal Bassetti et la Conférence Episcopale Italienne, qui avait eu la belle idée de rassembler à Bari en février 2020 plusieurs évêques dediocèses riverains de la Méditerranée. En 2022, une deuxième rencontre s’est tenue à Florence, qui coïncidait avec un congrès des maires de nombreuses villes de la Méditerranée. Cette initiative s’inscrivait dans l’héritage des “Colloques méditerranéens” des années 50, organisés par le célèbre maire de Florence, Giorgio La Pira.
Plus largement, ce processus s’inscrit dans l’esprit du « pèlerinage méditerranéen » du Pape François qui, de Lampedusa (2013)à Ajaccio (2024), en passant par Tirana, Sarajevo, Lesbos, Le Caire, Jérusalem, Chypre, Rabat, Naples, Malte ou Marseille, s’est engagé à faire de cette mer un message d’espérance pour le monde.
A la suite de ces premières rencontres, nous avons proposé, à l’occasion des rencontres méditerranéennes de 2023 à Marseille, d’associer des jeunes au travail des évêques. C’est ainsi que70 jeunes de toutes les nationalités méditerranéennes, de cultures et confessions différentes, se sont réunis pour une semaine de session et qu’ils ont pu participeraux travaux des évêques. Ces échanges particulièrement riches nous ont invités à poursuivre cette idée, en organisant une nouvelle rencontre de jeunes et d’évêques à Tirana, en Albanie, en septembre 2024.
En 2025, à l’occasion de l’année jubilaire, il était important deproposer un format différent ! C’est ainsi qu’est né le projet « MED25 – Bel Espoir – Navire-école de la Paix », une odyssée méditerranéenne à bord de laquelle embarqueront à partir de mars prochain 200 jeunes qui se relaieront par groupe de 25, pendant 8 mois de navigation, pour se former à la paix et vivre une expérience de dialogue et de fraternité. Se retrouver sur un bateau ou sur une barque présente un grand avantage, celui de ne pas avoir d’autre choix que de se rencontrer !
. Le cardinal Léon-Etienne Duval, père de l’Eglise qui est en Algérie, disait souvent que « l’avenir est à l’amitié ». Pensez-vous comme lui ?
Oui, c’est bien cette culture de la rencontrede laquelle naît l’amitié, que nous voulons faire grandir par ce projet. L’Eglise d’Algérie, par sa situation minoritaire, mais surtout à l’exemple de ses pasteurs comme Léon-Etienne Duval, Henri Teissier, ou Pierre Claverie, l’a parfaitement compris et a placé l’amitié au cœur de son apostolat. La mission de l’Eglise est d’être au service de l’amour dont Dieu aime le monde. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son propre fils »nous précise l’évangélistesaint Jean.
Dans un monde marqué par de nombreux défis, – les conflits meurtriers, les disparités économiques, l’environnement ou encore les mouvements migratoires –, je suis convaincu que nous sommes appelés à cultiverces« relations à hauteur de visage ». Ce sont elles qui ouvrent le chemin de l’avenir, c’est en elles que l’espérance se trouve. Un jeune couple parti en mission dans un quartierdéfavorisé de Marseille m’avait témoigné en des mots simples de cette primauté de l’amitié : « Avant, nous avions des idées sur l’Islam. Maintenant, nous avons des amis musulmans. »
La providence a voulu que le Cardinal Duvalmeurt le jour-même où ont été retrouvés les moines de Tibhirine assassinés, et que leurs funérailles soient célébrées ensemble en 1996 à Notre Dame d’Afrique à Alger. Quel exemple d’une amitié vécue jusqu’au bout, avec celui que Christian de Chergé appelait « l’ami de la dernière heure » !
. L’amitié qui va grandir entre les jeunes de diverses religions durant cette navigation au long cours est-elle simplement “une étape” dans le dialogue interreligieux entre eux ou l’essence même de ce dialogue?
Vous avez raison de le souligner, l’amitié est l’essence même du dialogue interreligieux. Il ne s’agit pas d’abord dedébattre sur ce que nous croyons et portons à l’intime de nos cœurs, encore moins de susciter une forme de syncrétisme qui nierait ce que chacun porte de précieux et d’irremplaçable. Le dialogue interreligieux est d’abord un dialogue au service de la paix. Il implique un travail intérieur de chacun, un élargissement du cœur. Plus profondément encore, il exige une conversion intérieure. Le dialogue, comme la paix, est chose précaire. Comme elle, il suppose un décentrement de soi, une sorte de renoncement profond à l’autojustification.
Les jeunes méditerranéens qui se joindront à l’odyssée MED25 embarqueront sur le Bel Espoiravec cet horizon en vue, pour bâtir des amitiés, et trouver, ensemble, comme le dit saint Jean XXIII, « ce qui est universel à l’espérance humaine », et que traduisent les mots de paix, de justice, d’amour et de vérité.
A l’issue de cette aventure, nous savons que les jeunes, de retour dans leurs pays,seront plus solides dans leurs engagements pour construire la paix.
. Comment situez-vous cette initiative du navire-école pour la paix dans le processus engagé par les évêques de la Méditerranée à Bari en 2020? Qu’en attendez-vous à terme ?
Cette aventure est à la fois la poursuite des précédentes initiatives, et une formidable opportunité pourle processus ecclésial méditerranéen. Ellepermet dans plus d’une vingtaine de villes et de ports de susciter des équipes d’accueil qui animeront colloques et festivals. Elle diffusera cet esprit d’audace et d’aventure qui consiste à « passer sur l’autre rive », cet esprit qui conduisit Paul à franchir le Bosphore.
Toutes ces rencontres, tous ces échangesserviront leprocessus plus large initié par le Pape Françoisqui souhaite un renforcementdes relationsecclésiales et humainesen méditerranée, et ceci pour une raison bien précise, celle de sauver des vies. Dans la suite de son discours prononcé à Marseille en 2023, le Pape m’a ainsi confié la tâche de constituer une commission préparatoire, composée d’évêques, d’experts, de jeunes et de personnes engagées dans divers réseaux de coopération. Ce sont bien les acteurs de la méditerranée, les évêques et les jeunes qui se rencontrent, les réseaux qui se constituent depuis plusieurs années, qui fondent ce processus au service de la paix et de la justice. La synodalité s’apprend d’abord par la rencontre, pas par les idées.
. Est-il encore possible de rêver avec Giorgio La Pira de faire de la Méditerranée un “Lac de Tibériade” de la fraternité universelle ?
En rêver, je l’ignore, mais l’espérer, certainement ! Une espérance qui n’est pas naïve, mais concrète et attentive. Une espérance qui n’est pas évasion, mais présence et souvent résistance. Une espérance qui n’est pas utopie, car elle entraîne avec elle foi et charité. Selon l’auteur de l’épître aux Hébreux, l’espérance est comme une ancre marine (Hb 6, 19) que la foi en la Résurrection du Christ nous invite à jeter dans l’au-delà du temps, afin que, fermement arrimés à elle, en ces jours qui sont les derniers, nous puissions témoigner de l’amour dont Dieu aime le monde, accueillir l’audace et la liberté dont cet amour est la source.
Giorgio la Pira n’a pas fait que rêver de fraternité, il l’a fondée en action.Nous aussi, nous voulons offrir notre fraternité à tous ceux qui accueilleront le Bel Espoir, dans la vingtaine de villes où il accostera. Les jeunes porteront le message de saint Charles de Foucauld qui souvent traversa la Méditerranée, entre France et Syrie, Terre Sainte et Italie, Maroc et Algérie. Il écrivait : « Je veux habituer tous les habitants : chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère universel. Ils commencent à appeler la maison « la fraternité » et celle m’est doux. » Alors, oui, comme Giorgio La Pira, comme saint Charles de Foucauld, nous nous prenons à rêver qu’un jour, la Méditerranée puisse vivre pleinement sa vocation et devenirla « mer de la fraternité ».
Propos recueillis par François Vayne