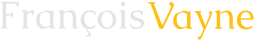« C’est l’heure pour nous de retourner à Jérusalem »

Repartons d’Assise
21 novembre 2025
Sur les hauteurs de Marseille, protectrice de la Méditerranée, Notre-Dame de la Garde est aujourd’hui plus belle que jamais !
8 décembre 2025Entretien avec Mgr Flavio Pace, Secrétaire du Dicastère pour l’unité des chrétiens
Le Pape François, qui s’était déjà rendu en Turquie en 2014, avait confirmé son intention d’y retourner pour les 1700 ans du Concile de Nicée. Son successeur, le Pape Léon XIV, réalise ce désir en novembre 2025. Recevant le 17 juillet à Castel Gandolfo une délégation orthodoxe-catholique des Etats Unis, guidée par le cardinal Tobin et le métropolite Elpidophoros, il avait affirmé sa volonté d’aller à Nicée pour une célébration œcuménique, se réjouissant que cette année les deux calendriers en usage dans nos Églises aient coïncidé de sorte que nous avons pu chanter à l’unisson l’Alléluia de Pâques. Mgr Flavio Pace commente pour nous cet évènement des 1700 ans du Concile de Nicée, à la lumière de l’actualité de l’Eglise, 60 ans après Nostra Aetate, la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse :
. Nous célébrons en cette année 2025 les 1700 ans du Concile de Nicée, assemblée œcuménique d’évêques qui formula le Credo, pilier central de l’identité chrétienne. Aujourd’hui qu’est-ce que cet anniversaire veut signifier en profondeur pour les chrétiens ?
Positivement nous pouvons dire qu’à l’époque l’exigence du concile s’est imposée pour préciser en qui nous croyons, car l’intérêt pour la personne de Jésus risquait – avec les théories d’Arius, un prêtre d’Alexandrie – de souligner davantage son humanité que sa divinité. Une divergence sur la nature du Christ mettait en péril l’unité de la chrétienté. La question qui se posait était de savoir si Jésus est à la fois homme et Dieu. Dans ce contexte, Jésus était au centre des discussions. Cela nous rejoint comme chrétiens aujourd’hui dans le sens où nous devons remettre Jésus au cœur de nos vies, non pas comme le désirons personnellement mais comme les Evangiles nous le présentent et selon ce que la tradition de l’Eglise nous a transmis. Il ne s’agit pas d’inventer des choses nouvelles sur Jésus mais d’exprimer dans le langage de notre temps le mystère du Verbe qui s’est fait chair pour notre salut. Le Jésus que parfois nous construisons, comme un champion ou un héros, n’a rien à voir avec le Fils de Dieu, à la fois vrai Dieu et vrai homme, qui s’est incarné pour que nous le reconnaissions en chaque créature humaine, à commencer par la plus petite et la plus humble.
. La tradition populaire présente à Jérusalem une grotte, sur le mont des oliviers, où les apôtres auraient écrit les articles du Credo. Des pèlerins en ont témoigné dans leurs récits au cours des siècles passés, tel que Francesco Guerrero, prêtre de Séville et musicien espagnol, au XVIème siècle. Au Palazzo della Rovere, sur la via della Conciliazione à Rome, une fresque datant de 500 ans évoque cela en attribuant chaque article du Credo à un apôtre. Cette tradition indique-t-elle que le Concile de Nicée n’a fait que reformuler officiellement, en l’adaptant, le Symbole des Apôtres qui était déjà connu des fidèles et récité par eux depuis les temps apostoliques ?
. C’est très intéressant de tenir compte des récits des pèlerins qui se sont rendus en Terre Sainte au cours des siècles, comme Égérie par exemple, en 380, ou encore le pèlerin espagnol que vous citez. Même si cette tradition populaire n’est pas scientifiquement fondée au plan historique, elle montre comment la foi s’est transmise par l’intermédiaire du peuple, de la communauté. J’aime particulièrement me recueillir dans la basilique du Saint-Sépulcre sur un lieu précis où la tradition dit que la Vierge Marie aurait vu le Christ Ressuscité avant tous les autres. C’est beau d’imaginer que celle qui a donné chair au Verbe soit la première à l’accueillir vivant éternellement dans la lumière de la Résurrection. S’agissant de la grotte des apôtres où ils auraient rédigé le Credo, nous ne pouvons ni confirmer ni nier cette tradition mais il est clair qu’elle manifeste que la foi essentielle, la foi baptismale, est transmise comme un don reçu. Les apôtres n’ont rien inventé, la preuve est qu’ils avouent leurs faiblesses dans les Evangiles, leurs reniements, leurs fuites, n’ayant que la grâce de Dieu à offrir et pas leur bravoure ! Comme dit saint Paul, nous portons un trésor dans des vases d’argiles, et il est indéniable que les apôtres étaient des vases d’argile… Cela nous interpelle car, pas meilleurs qu’eux, nous avons à transmettre ce que les apôtres nous ont transmis. Le Concile de Nicée, en 325, a complété le Symbole des Apôtres qui était une profession baptismale des premiers chrétiens. À l’origine, le mot grec symbolon désigne un morceau de terre cuite partagé en deux. Il désigne « un objet de reconnaissance » coupé en deux parties, chacune permettant à des messagers ou porteurs à se reconnaître en les emboîtant. Le « symbole de la foi » est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Celui de Nicée reprend le Symbole des Apôtres avec d’autres mots, sans en changer le sens, et il sera lui-même complété ensuite par le concile de Constantinople, en 381, au cours duquel les évêques confirmeront que l’Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils, partageant la même nature divine. La liturgie permet la récitation de deux credos différents : le Symbole des Apôtres et celui de Nicée-Constantinople. Dans le Missel il est stipulé qu’à la place du symbole de Nicée-Constantinople, particulièrement en Carême et au temps pascal, il est possible d’utiliser le symbole baptismal de l’Église romaine, dit Symbole des Apôtres. Le choix du Credo à réciter le dimanche revient au prêtre et à l’évêque local. Il y a d’autres professions de foi chrétienne, avec des variantes de langage, en particulier dans les Eglises Orientales, syriaque notamment, mais aussi dans le rite ambrosien de Milan où l’on récite le Symbole d’Athanase d’Alexandrie à un certain moment de l’année. L’ouvrage Symboles et définitions de la foi catholique, communément appelé le Denziger, du nom du théologien allemand du même nom, rassemble ces divers credos qui témoignent de la liberté d’expression chrétienne autour d’une même foi.
. L’unité des chrétiens se réalise parfois sous nos yeux de manière inattendue, comme à Gaza, le 17 juillet 2025, quand fidèles catholiques et orthodoxes ont subi le bombardement israélien qui a causé trois morts et une dizaine de blessés. Le lendemain les patriarches latin et orthodoxe de Jérusalem étaient ensemble à Gaza pour visiter leurs communautés, unies sous le signe de la croix de l’église de la Sainte Famille qui était restée intacte malgré les dommages causés au bâtiment. Comment interprétez-vous ces faits ?
. L’unité des chrétiens doit être une unité dans la foi, selon ce que le concile Vatican II a indiqué, et nous devons pour cela continuer à dissiper les doutes et des incompréhensions par le dialogue et les rencontres. Cependant, certainement, le protagoniste de l’unité n’est pas un bureau, c’est le Saint Esprit. Le fait qu’à Gaza la paroisse catholique accueille les fidèles orthodoxes depuis des mois, le fait que parmi les morts de juillet il y ait une victime orthodoxe et deux victimes catholiques, le fait que le Patriarche latin et le Patriarche orthodoxe aient attendu quatre heures au checkpoint pour pouvoir entrer et visites leurs fidèles, tout cela est une parole pour le monde et pour les Eglises : sous le signe de la souffrance et de la croix, l’unité avance, mystérieusement. Le martyre commun au Moyen-Orient nous fait assoir à la même table eucharistique, qui n’est pas encore la célébration sacramentelle mais qui est la célébration du mystère de la croix, unique source de l’unité tant souhaitée par Jésus lors de son dernier repas : « Que tous soient un » (Jn 17,21).
. Cette année marque aussi les 60 ans de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, sur les relations de l’Église catholique avec les religions non chrétiennes, un texte fondateur des relations interreligieuses contemporaines. Comment concilier la profession de foi, la récitation du Credo qui implique la mission, et le dialogue avec les autres religions où les fidèles catholiques sont appelés à reconnaitre ce qui est « vrai et saint » ?
Initialement le projet de Jean XXIII, à la suite de sa rencontre avec Jules Isaac, ne devait concerner que les rapports entre christianisme et judaïsme, mais il fut élargi par la suite aux autres religions non chrétiennes. L’anniversaire de Nostra Aetate doit donc être d’abord célébré par rapport aux relations judéo-chrétiennes, très difficiles en ce moment de l’histoire à cause de la guerre en Terre Sainte. C’est justement quand c’est difficile de se comprendre que nous devons chercher à dialoguer encore plus. De plus, il faut situer Nostra Aetate dans l’ensemble du Concile et se souvenir que cette déclaration d’octobre 1965 est suivie en novembre par la constitution dogmatique Dei Verbum sur la Révélation divine, solennellement promulguée par Paul VI. Cette constitution dogmatique montre que le Dieu invisible dans son grand amour s’adresse à nous les hommes comme à des amis, inscrivant ainsi la Révélation dans un processus de dialogue personnel et de relation. Il est clair dans cet esprit que c’est justement parce que je suis ami du Dieu de Jésus Christ que je ne peux pas fermer la porte à ceux qui pensent différemment autour de moi. L’approche n’est pas d’imposer une vérité mais de témoigner d’une relation avec le Dieu vivant qui me porte à rencontrer l’autre, de chaque autre. La mission se vit dans le cadre d’un partage des dons. Si le centre est Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître autour de nous, par cercles concentriques, ce que les pères de l’Eglise appellent « les semences du Verbe », des semences de vérité suscitées par l’Esprit de Dieu, sans oublier que dans le judaïsme sont nos racines puisque le Christ est fils de la promesse faite à Israël.
Avec le Concile et Nostra Aetate, l’Eglise catholique a fait son autocritique par rapport à ses relations passées difficiles avec le peuple juif, peut-on s’attendre aussi à des remises en question de la part des autorités rabbiniques concernant certains enseignements par rapport au monde chrétien ?
. Nous savons que des jeunes suprémacistes juifs se comportent mal avec les pèlerins chrétiens en Terre Sainte et leurs actes antichrétiens sont documentés notamment par le rapport annuel du Rossing Center, une ONG israélienne qui se veut interconfessionnelle. Le monde juif n’est pas organisé de façon hiérarchique comme l’Eglise catholique et il n’y a pas une unique autorité avec laquelle dialoguer de ces questions, qui touchent à l’éducation en particulier. Aussi, ce sont les liens interpersonnels qui comptent et il est plus urgent que jamais de dialoguer dans la franchise réciproque avec les rabbins que nous connaissont, afin qu’ils révisent les textes religieux enseignés aux jeunes dans une perspective de respect et de paix. Les problématiques politiques et religieuses s’entrecroisent hélas mais nous avons le devoir de cultiver la dimension spirituelle dans nos rapports, en cherchant à renouveler la formation des personnes, jeunes et adultes, dans une dynamique de respect mutuel. L’Eglise catholique ne peut pas rester seule à faire son mea-culpa et les représentants des autres religions ont à prendre eux aussi leurs responsabilités face à l’histoire.
Pour conclure, quel fil d’or voyez-vous dans votre mission au service de l’Eglise ?
. Ordonné prêtre à Milan par le cardinal Carlo Maria Martini, j’ai été marqué par son enseignement, en particulier par rapport à ce qu’il disait sur nos racines spirituelles qui sont à Jérusalem et sur la nécessité de servir l’unité des chrétiens en repartant de nos origines. J’ai respiré cet enseignement qu’il vivait personnellement, et je suis allé le visiter à Jérusalem où il avait choisi d’habiter une fois retiré. L’unité qu’il désirait hâter, que le concile de Nicée illustre avec le Credo, n’est pas l’uniformité. Dans mon diocèse de Milan la liturgie n’est pas romaine de tradition, mais ambrosienne, et cette expérience m’a préparé au service que j’ai rendu précédemment au Dicastère des Eglises orientales. Être catholique ne coïncide pas forcément avec la tradition romaine et latine. La diversité ne nuit pas à l’unité mais la manifeste, dans la mesure où le centre est Jésus-Christ. Les Eglises catholiques orientales ont beaucoup à nous apprendre dans cette perspective, pour vivre le lien avec l’évêque de Rome comme un lien qui promeut la communion et non la soumission. Le Pape Léon XIV l’a rappelé en substance devant la délégation orthodoxe-catholique des Etats Unis en juillet : ne cherchons pas qui a le primat car Pierre et André venaient de Jérusalem, alors tous ensemble nous devons faire l’expérience de retourner à Jérusalem, d’y revenir, spirituellement, pour retrouver le cœur de la foi qui nous unit. Sur mon anneau épiscopal est d’ailleurs figuré le pélican, unique symbole chrétien représenté au Cénacle à Jérusalem, signe de la charité et du sacrifice du Christ, qui verse son sang pour le salut du genre humain. Dans cet esprit, c’est l’heure pour nous de retourner à Jérusalem! Ma devise, tirée d’une hymne de saint Ambroise à la Trinité, évoque la chaleureuse tendresse divine qui couve la vie et la génère, « Fove precantes Trinitas” – c’est-à-dire Protège ou réchauffe ceux qui prient, ô Trinité – comme pour signifier que le chemin de l’unité est d’abord une supplication adressée à Dieu avec nos cœurs ouverts les uns aux autres pour accueillir ensemble le don qu’il veut nous faire.
Propos recueillis par François Vayne